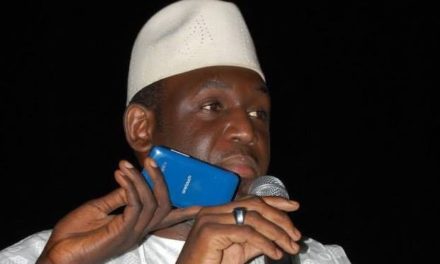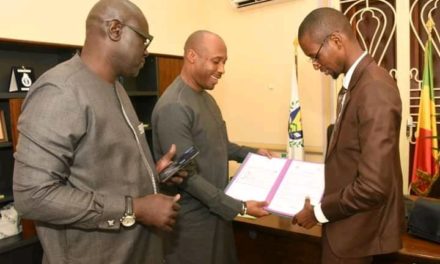NETTALI.COM - L'ancien pape Benoit XVI est décédé le 31 décembre à 95 ans. Depuis qu'il avait renoncé à sa charge le 11 février 2013, cette figure du conservatisme doctrinal vivait dans le monastère Mater Ecclesiae, au cœur de la cité vaticane. Portrait.
Le « pape émérite » Benoit XVI s’est éteint ce 31 décembre à l’âge de 95 ans dans les murs du petit monastère Mater Ecclesiae, au cœur de la cité vaticane, qu’il occupait depuis sa renonciation en 2013. Jusqu’à la fin de sa longue vie, l’odeur sucré du Kirschmichel, la recette de clafoutis bavarois préférée du prélat allemand Joseph Ratzinger, aura flotté dans les couloirs d’une maison tenue par quatre sœurs laïques et gouvernée par l’archevêque Georg Gänswein, son fidèle secrétaire particulier. Jusqu’à la fin aussi, l’ombre de ce défenseur acharné du dogme catholique aura plané sur le règne de son successeur François.
Remarqué dans les coulisses du concile de Vatican II (1962-1965) comme jeune réformateur zélé et prometteur, ce théologien passionné, plus à l’aise dans les rôles d’homme d’influence et de réseau que dans celui de pasteur-berger des âmes, s’est imposé au fil des ans comme la figure emblématique du conservatisme doctrinal au sein de l’Église catholique. Loin d’être intégriste, il n’en sera pas moins un adversaire acharné des profondes réformes sociales et structurelles espérées aujourd’hui par tant de croyants, comme l’ordination des femmes à la prêtrise, la reconnaissance du mariage homosexuel ou l’ouverture de la gestion de l’Église aux laïques, le tout au nom de la défense des dogmes et de la cohésion d’une Église millénaire.
SITUATION MODESTE
Joseph Ratzinger est né le 16 avril 1927, benjamin d’une fratrie de trois, à Marktl-am-Inn, non loin de la frontière autrichienne, dans une Basse-Bavière paysanne et ultra-catholique. Son grand-oncle est docteur en théologie et député au Reichstag pour le Parti paysan bavarois. Son père est gendarme, jamais encarté au NSDAP, et sa mère cuisinière. La Bavière est alors un état rural plutôt pauvre dans une Allemagne vaincue, en pleine crise économique, politique et morale. Malgré une situation modeste, les époux Ratzinger élèvent leurs enfants dans la foi catholique traditionnelle et trouvent les moyens de placer Joseph et son frère ainé Georg (futur prêtre et chef de cœur des célèbres Moineaux de la cathédrale de Ratisbonne) au Séminaire Saint-Michel de Traustein, ville où la famille s’est fixée après l’entrée en retraite du père.
Cet internat qui prépare aussi à la prêtrise, est déjà un terrain de lutte entre l’Église régionale et les nazis, obsédés par le contrôle des jeunes esprits, qui ne manquent pas une occasion de perturber les cours. C’est là que le futur pape choisit le camp de la religion. Mais, à 14 ans, il n’échappe pas à l’incorporation obligatoire dans les jeunesses hitlériennes, puis à une formation de « Flakhelfer », c’est-à-dire assistant sur une batterie anti-aérienne.
Né en 1930, l’ancien chancelier Helmut Kohl, a lui aussi été « Flakhelfer ». Le parcours est un classique pour les jeunes Allemands qui ont moins de 18 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, en 1944, Ratzinger officiera, durant quelques mois, à la Wehrmacht. « L'enfer, c'est de vivre dans l'absence de Dieu », dira Benoit XVI en qualifiant le nazisme de « domination du mensonge » et de « régime de la peur », en 2004, à Caen, lors des célébrations du 60e anniversaire du débarquement allié.
Après un court passage dans une prison américaine, Joseph Ratzinger entame ses études de théologie, d'abord à l'école de philosophie et de théologie de Freising, puis à l'université de Munich. Le 29 juin 1951, il est ordonné prêtre en même temps que son frère Georg. Après une brève activité pastorale à Munich, il opte pour la recherche et l’enseignement. Quatre ans et un doctorat plus tard, à l'âge de 30 ans, il devient enfin professeur de dogmatique à l'université théologique de Freising. En 1959, il est enfin nommé titulaire de la chaire de théologie fondamentale à Bonn.
Ce poste le rapproche de l’Archevêque de Cologne et cardinal Joseph Frings qui en fait son conseiller en théologie, notamment lors des travaux du Concile Vatican II. C’est un tournant dans sa carrière. C’est en effet à la suite d’un discours de Frings, rédigé en grande partie par Ratzinger, que l’Église romaine décide de réformer le Saint-Office, héritier direct de la sombre Inquisition. Le jeune professeur de théologie allemand se lie aussi d’amitié avec un certain Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II.
En 1965, le pape Paul IV remplace donc le Saint-Office par la Congrégation pour la doctrine de la foi. La méthode punitive disparait mais le pouvoir de contrôle subsiste. Comme le précise plus tard Jean Paul II, la nouvelle congrégation a pour tâche « de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique : tout ce qui, de quelque manière, concerne ce domaine relève donc de sa compétence ». On imagine aisément le poste de pouvoir que représente la direction de cette congrégation. Et c’est précisément à ce poste, en 1981, que le pape polonais nomme son ami Ratzinger qui est, entre temps, devenu archevêque de Munich et Freising et cardinal (1977).
DOYEN DU COLLÈGE DES CARDINAUX
Joseph Ratzinger, dirige cette congrégation jusqu’à son élection à la fonction suprême en 2005. Il est aussi nommé doyen du Collège des cardinaux en 2002, le collège qui élit le pape. Quand Jean-Paul II meurt, l’Église catholique est déjà profondément ébranlée par les multiples révélations sur toute la planète de cas pédophilie. Un vent de rébellion et de rejet souffle contre une institution ecclésiastique habituée à gérer ses problèmes en secret. Les cardinaux paniquent et Joseph Ratzinger a toutes les cartes pour s’imposer comme la solution la moins aventureuse.
Pour le théologien suisse Hans Küng, interviewé par le quotidien genevois Le Temps, quelques jours avant l’élection, l'Église catholique a besoin d'un pape capable d'accomplir des réformes internes, inspiré par l'Evangile et non par le droit canon médiéval, « garant de la liberté de parole et de l'ouverture à l'intérieur de l'Église ». « Le nouveau pape devrait être un évêque qui respecte la collégialité, pas un autocrate. L'Église a également besoin d'un pasteur qui soit l'ami des femmes, qui refuse tout sexisme et patriarcalisme », explique alors cet ancien théologien officiel du concile Vatican II, interdit d’enseignement en 1979 à la suite de ses critiques sur l’infaillibilité papale, le tout sur instigation de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dirigée par Ratzinger.
POINT DE VUE CONSERVATEUR
Ce dernier ne voit plus du tout les choses du même œil que le théologien avec qui il a pourtant travaillé main dans la main lors du synode de Vatican II « pour faire entrer un courant d’air frais dans l’Église » qui livre l’analyse suivante en 1984 : « On s’attendait à un bond en avant et l’on s’est trouvé au contraire face à un processus progressif de décadence qui s’est développé dans une large mesure en se réclamant du Concile et qui, de cette manière, l’a de plus en plus discrédité... Le bilan semble donc être négatif : il est incontestable que les dix dernières années ont été décidément défavorables pour l’Église catholique », écrit-il en position de réaction.
L’élection de Benoit XVI a finalement lieu du 18 au 19 avril 2005. Elle est bouclée en seulement quatre tours de scrutins. Un record. Commence alors un règne papale ponctué de dérapages et de malentendus. Dès 2006, Benoit XVI se met le monde musulman à dos lors d’un discours prononcé à Ratisbonne sur les rapports entre la foi, la science et l’enseignement. Il y emploie deux citations présentant l’Islam sous un jour extrêmement négatif. « Ce ne sont pas pour autant mes positions », se justifiera-t-il ensuite. Trop tard. Le mal est fait et débouche sur des attaques d’églises, la mort d’une religieuse somalienne et dix ans de froid avec le monde islamique.
LA MESSE SELON LE MISSEL
En 2007, dans sa lettre apostolique Summorum Pontificum, le pape Benoit XVI réautorise aussi la messe selon le missel de 1962 qui reconnait le rituel ancien dit tridentin, pratiqué jusqu’à la publication du Missel de Vatican II en 1970. Cette décision satisfait les traditionalistes et va notamment conduire à la réouverture des discussions entre le Vatican et la Fraternité Saint Pie X, fondé par le cardinal intégriste Marcel Lefevre, et la levée de l’excommunication des évêques de ladite Fraternité. En 2021, le Pape François interdira à nouveau l’utilisation du missel de 1962.
Sur les scandales de pédophilie, le pape Benoit, aussi connu pour refuser toute officialisation de l’homosexualité ou pour douter de l’efficacité du préservatif contre le Sida, ne manquera pas d’exprimer sa honte et ses remords. « J’ai eu de grandes responsabilités dans l’Église catholique. Ma douleur est d’autant plus grande pour les abus et les erreurs qui se sont produits au cours de mon mandat en différents lieux », expliquera-t-il des années plus tard. Sous son règne, la Congrégation pour la doctrine de la Foi en charge de ces questions n’a pas rien fait pour écarter et punir les prêtres coupables. Mais elle a surtout laissé les Églises locales gérer le problème sans tirer les conclusions profondes qu’appellent ces scandales. À savoir que nombre des abus et dissimilations ont pu avoir lieu parce que les structures ecclésiastiques sont opaques, autocratiques et laissent peu de place aux croyants.
En 2019, Benoit explique ainsi les affaires de pédophilie par un recul de la foi dans la société, associé à la libéralisation des mœurs des années 60. Mais rattrapé par son histoire et les recherches d’un cabinet d’avocats en février 2022, il doit cependant reconnaître, trois semaines après l’avoir nié, qu’il a bien participé à une réunion en tant qu’archevêque de Munich, où a été décidé la réintégration d’un prêtre pédophile dans le service actif de l’Église.
2013 : LE RENONCEMENT À SA CHARGE DE PAPE
En février 2013, dans le sillage du scandale des « Vatileaks » (mai 2012) qui correspond à la fuite et la publication de documents confidentiels du Vatican, dont une partie de sa correspondance, le 265ème pape de la Chrétienté décide de renoncer à sa charge, « conscient de n’être plus en mesure d’accomplir le ministère pétrinien avec la force qu’il demande ». Seuls dix papes ont franchi ce pas. Mais neufs d’entre eux y ont été forcé. Benoit XVI est le seul à l’avoir fait de son plein gré.
Son retrait au cœur du Vatican ne lui a cependant pas coupé l’envie de peser sur le cours de l’Église. Plusieurs indices le montrent. Par exemple son choix de s’auto-nommer « Pape émérite », un titre qui n’a jamais existé mais qui signifie bien son intention de ne pas complètement abandonner son titre. Légèrement énervé, son successeur François n’a jamais voulu ouvrir une polémique sur ce point mais n’a pas manqué de parler de lui comme son « grand-père sage à la maison ».
Assagi, ce grand-père déçu par « une société occidentale où Dieu a disparu de l’espace public » , ne l’aura jamais été. Depuis sa retraite, il s’est fait remarquer par des prises de positions intempestives contre le mariage homosexuel et pour le célibat des prêtres. Il a aussi prévu l’après grâce aux « Cercles des anciens élèves de Joseph Ratzinger ». Ceux-ci réunissent au moins une fois par an une assemblée composée de jeunes théologiens et d’une vieille garde, comme les cardinaux conservateurs Kurt Koch et Gerhard Ludwig Müller, avec pour objectif d’étudier et de propager les positions de l’ancien pape. C’est-à-dire de condamner la plupart des expériences actuelles de réforme de l’Église.