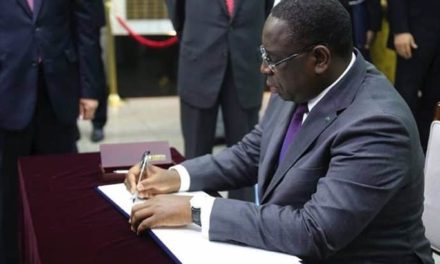IlNETTALI.COM - C’est comme si une situation sociale fiévreuse s’était subitement emparée du pays. Ce qui augure d’une ambiance générale pas très apaisée. Ce sont en effet des revendications tous azimuts qui sont notées dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la santé et de la justice. Pour ne pas dire l’essentiel des secteurs dont la gestion est dévolue à l’Etat.
Après les syndicats de l’enseignement supérieur, au mois de janvier sur des questions de retraite, le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a annoncé une grève de 48 heures, les mardi 18 et mercredi 19 février 2025, pour protester contre le non-respect des engagements pris par le gouvernement relatifs aux pensions de retraite des enseignants-chercheurs décédés et au retard dans l’adoption d’un décret attendu depuis plusieurs mois. L'objectif étant selon eux, de faire entendre raison à Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur.
En effet, le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) ne cache pas son amertume par rapport à la dernière sortie de la tutelle dans une télévision de la place. Réuni le dimanche 16 février, le Bureau national de l'organisation syndicale dénonce “le non-respect de l'engagement pris le 22 octobre 2024 par le Mesri, “en accord avec le gouvernement”, de “réintroduire le décret, objet de la revendication, dans le circuit d'adoption des textes administratifs”.
Les universitaires dénoncent aussi “le non-respect par le gouvernement de la clause de confiance du 16 décembre 2024, entre le Saes et le gouvernement, représenté par le ministre secrétaire général du Gouvernement, mandaté par le Premier ministre, engageant la responsabilité du gouvernement de signer en l'état le projet de décret”. Si le Saes est en grogne, c'est aussi du fait du “mutisme et l'indifférence” du Mesri à propos des points du “préavis de grève du 13 janvier 2025 arrivé à expiration”.
Le secteur de la santé lui aussi, commence à connaître des perturbations. Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) qui avait annoncé une grève générale les 18 et 19 février 2025, va mettre sa menace en exécution. En effet, après 14 rencontres avec le gouvernement sans succès, le Sames a décidé, comme il l'avait annoncé lors d'un point de presse du lundi 17 février par le secrétaire adjoint du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) d’observer une grève de 48 heures, à partir du mardi 18 février. Seules les urgences seront prises en charge dans les établissements sanitaires publics. Quant à la baisse des salaires annoncée récemment par Al Aminou LO, le secrétaire général du gouvernement, ils se disent ne pas être concernés. Le secteur public de la santé sera donc paralysé, les mardi 18 et mercredi 19 février. Seules les urgences seront prises en charge.
Du côté de la justice, le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST), connu pour ses revendications récurrentes, sans doute par manque de solutions qui perdure, a déposé un préavis de grève, le 07 février 2025, avec pour objectif de mettre le Gouvernement face à ses responsabilités, sur des questions relatives à des reclassements et indemnités de participation à la judicature, sans oublier l’octroi de l’indemnité de logement à tous les agents du Ministère de la Justice.
De même, face à des fermetures d’entreprises et ce qu’elles qualifient de licenciements massifs et abusifs de travailleurs dans les entreprises et services de l’Etat, ainsi que de violations des droits des travailleurs, des centrales syndicales regroupées autour d’un front syndical de la défense du travail, envisagent de déposer un préavis de grève générale auprès des autorités pour les dénoncer. C’est ce qu’a annoncé un communiqué qui fait suite à une Assemblée générale tenue, le vendredi 14 février, à la bourse du travail de la CNTS Keur Madia.
Une situation qui découle d’un constat d’un manque de réactivité du gouvernement par "l’assemblée générale dans le but d’apporter des solutions durables aux problèmes posés par les organisations syndicales."
Dans le monde estudiantin également, les revendications semblent se généraliser. En effet, dans un passé récent, plus exactement au mois de novembre, l’Université Assane Seck de Ziguinchor était en grève pour des raisons liées à un manque de salles et de logements. Ce qui avait d’ailleurs abouti à la fermeture temporaire de l’université et la dissolution des organisations d’étudiants à la suite de violentes troubles.
En ce mois de février, ce sont les étudiants de Dakar qui manifestaient violemment sur fond d’affrontements avec les forces de défense et de sécurité, réclamant le paiement de leurs bourses qui a connu un retard avec quelques mois d’arriérés cumulés.
Le mardi 11 février, de violents affrontements ont éclaté entre les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès et les forces de défense et de sécurité. La cause, des questions d’infrastructures.
Le mercredi 12 février, les étudiants de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont barré la route nationale numéro 1 et brûlé des pneus, pour dénoncer leurs "mauvaises conditions" d’études.
Bref, une situation de revendications certainement pas nouvelle, mais qui incite à s’interroger sur la conduite du pays, alors que les piliers de la société que sont la santé, l’enseignement supérieur et par ricochet, la recherche et la justice, connaissent tous des soubresauts.
C’est la question même de la capacité de l’Etat à tenir ses engagements qui est interpellée ; voire sa capacité à négocier avec les syndicats et à les calmer même dans un contexte où les moyens financiers font défaut.
Au-delà, sur la question de la gestion des universités, il est sans doute temps que soit opéré un changement de paradigmes dans le système d’enseignement et de formation. En effet, au fil des années, la massification dans les universités s’accentue, alors que les capacités d’accueil, d’hébergement et de prise en charge alimentaire n’augmentent pas en conséquence. Cette même massification contribue à faire baisser la qualité des enseignements avec comme conséquence, une dépréciation du niveau.
Une question importante que l’on devrait dès lors se poser, est de savoir si la majorité des élèves du Sénégal ont vocation à poursuivre des formations supérieures à l’université ? Une fois qu’on arrivera à réaliser que l’enseignement supérieur doit être réservé à des élèves d’un certain niveau et que d’autres catégories d’élèves doivent être orientés vers des formations professionnelles, tenant compte de leurs prédispositions et talents, l’on résoudra le problème de la massification qui est, entre autres, la cause de toutes ces crises.
Le montant de 80 milliards, sans que ce ne soit des chiffres officiels, est ainsi avancé dans le logement et la nourriture ; et 40 milliards pour leur formation.
Comment par exemple comprendre que l’Université de Dakar, à elle seule, puisse compter un effectif de 100 000 étudiants ? Comment imaginer des effectifs de presque 4000 étudiants en première année de droit, de lettres, etc avec 150 à 200 étudiants qui atteindront le cap du Master 2 ?
Le niveau de déperdition est en effet tel que l’on peut se demander si la vocation de l’université ne serait pas finalement de faire de l’institution supérieure, une garderie d’adultes, en sachant que beaucoup d’entre ces étudiants percevront des bourses, seront logés et nourris à moindre frais ; sans oublier ceux qui auront eu l’occasion de percevoir des bourses ou demi-bourses, sans toutefois avoir fréquenté le moindre amphithéâtre ou étudié dans une logique de réussite.
Mais pour que les formations soient attractives, il faudrait bien qu’elles soient adaptées aux besoins des entreprises, de manière à ce que les étudiants formés, puissent par la suite, trouver des débouchés.
En somme, ce sont des problèmes et des revendications presque généralisés en cours, pas simples à résoudre, surtout que le président de la république a récemment annoncé des marges budgétaires presque inexistantes. Au même moment est annoncée une réduction des dépenses publiques, mettant en avant une baisse des salaires dans certains segments, une réduction des exonérations fiscales et des subventions, notamment sur l’électricité, le carburant entre autres. Sans oublier la nécessité de rationaliser le fonctionnement de l’État, notamment en supprimant les agences jugées superflues.